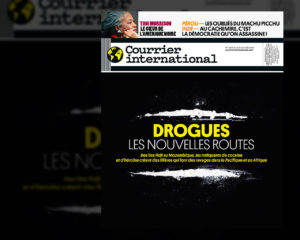
Publié le 14/08/2019
Cette semaine, nous avons choisi de consacrer notre dossier de couverture aux nouvelles routes de la drogue. Cap sur les tropiques pour la cocaïne et l’héroïne, aurait-on pu titrer. Parce que les tendances qui se dessinent sont des tendances lourdes, qui révèlent à quel point les trafiquants s’adaptent aux changements géopolitiques pour diversifier leurs circuits de distribution et inonder de nouveaux marchés. La guerre contre la drogue, quoi qu’on puisse en penser, est bel et bien perdue d’avance. Entre 2009 et 2017, la consommation mondiale de stupéfiants a ainsi augmenté de 30 % selon le dernier rapport de l’Office des nations unies contre les drogues et le crime (Onudoc). Et l’inventivité des cartels et autres mafias pour déjouer les systèmes de surveillance semble n’avoir plus de limites.
Océanie, Afrique, États-Unis… C’est la conjonction de plusieurs articles publiés sur le même sujet et dans des zones géographiques variées qui nous a décidés à “monter” ce dossier. L’un du Guardian, sur la route de la cocaïne dans le Pacifique, l’autre de The Economist sur les nouvelles filières de l’héroïne en Afrique. Les ravages sont considérables, des îles Fidji au Mozambique. Enfin, un troisième du quotidien croate Vecernji List sur la route des Balkans.
Que racontent au fond ces trois articles ? La même chose. On a longtemps pensé que les consommateurs de drogues se trouvaient au nord, dans les pays riches, et les producteurs “au sud”, dans les pays dits en développement. En fait, comme pour les autres secteurs d’activité, les trafiquants se sont adaptés au marché. Et ce sont aujourd’hui les pays émergents qui dopent la demande.
Décrypter, donner du sens à des actualités, proposer des articles qui ont été publiés dans des médias de pays différents, les faire se répondre, se contredire et se compléter, en respectant bien sûr les textes originaux et l’intention de leurs auteurs. C’est là notre responsabilité éditoriale.
Courrier international est un hebdomadaire à part, au sens que nous n’envoyons pas de journalistes en reportage, nous ne produisons pas d’analyses, mais nos équipes lisent, sélectionnent et traduisent pour vous le meilleur de la presse internationale. Qu’elles contextualisent ensuite pour vous permettre de mieux comprendre un phénomène, qu’il soit local, régional ou mondial.
Nous sommes un peu la chambre d’écoute du monde. Dans l’avalanche d’informations qui finit par nous submerger, il s’agit pour nous de renvoyer l’écho le plus juste de ce qui s’écrit ailleurs, des analyses et des tendances de la presse russe, britannique, chinoise, arabe… Il s’agit de repérer les liens et les correspondances, d’être surpris et de vous surprendre, de déplacer notre regard. Nous regarder d’ailleurs, et regarder ailleurs.
Chaque semaine, dans cette colonne, plutôt qu’un édito, nous tenterons de mieux faire comprendre nos choix, notre sélection. Face à la défiance croissante affichée à l’égard des médias – et dont nous ne pouvons pas ne pas tenir compte –, il me paraît plus que jamais nécessaire d’expliquer les coulisses de notre travail, en toute transparence, et de montrer la richesse et la pluralité de la presse mondiale.
Cette confrontation permanente des idées est au cœur de l’identité de Courrier international. Cela ne changera pas.
Éric Chol a quitté le journal début juillet. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Je le remplace à la direction de la rédaction après avoir travaillé sept ans à ses côtés. Avec quelques idées simples en tête : anticiper les problématiques de demain, raconter le monde différemment, en esquissant toujours un pas de côté (grâce au regard de la presse étrangère) et vous donner à vous, lecteurs, le même plaisir à lire l’hebdomadaire et notre site que nous avons à les faire.
Claire Carrard
Source : Courrier International
====::====
Enquête. Les îles du Pacifique, étapes de plus en plus prisées sur la route de la cocaïne
THE GUARDIAN – LONDRES
Publié le 11/07/2019
Aurélie Boissière pour Courrier international
Depuis cinq ans, les saisies de drogue dans les îles du Pacifique ont augmenté de manière significative. Devenus lieux de passage du trafic entre le continent américain et l’Australie, ces archipels constatent une augmentation de la consommation et de la criminalité. L’enquête du Guardian.
C’est la route de la drogue dont vous n’avez jamais entendu parler. Dans des coques de voiliers, des milliards d’euros de cocaïne et de métamphétamine transitent des États-Unis et d’Amérique latine vers l’Australie. Cette route passe par des îles du Pacifique plus connues pour leurs paysages idylliques que comme des plaques tournantes du narcotrafic.
Depuis cinq ans, ces transports de parfois plus d’une tonne de cocaïne se multiplient de façon exponentielle dans le Pacifique, vers un marché australien en plein essor et extrêmement lucratif. Plusieurs pays servent d’étapes involontaires dans ce trafic, comme les îles Fidji, où nous nous sommes rendus, mais aussi le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga et la Nouvelle-Calédonie, dont les eaux territoriales et les plages voient passer, pour des durées plus ou moins longues, des milliards d’euros de substances illicites.
Des centaines de kilos de cocaïne font surface sur de lointaines plages du Pacifique, des bateaux chargés de drogue s’échouent sur des récifs coralliens au milieu de nulle part, des habitants découvrent des cargaisons englouties dans des filets lestés au fond de l’eau et attachés à des balises GPS.
« Si vous tracez une ligne directe de Bogota à Canberra, elle passe par ces îles », constate simplement Andreas Schloenhardt, professeur de droit pénal à l’université du Queensland (Australie).
Des saisies en forte hausse
Certes, il existe une route de la drogue dans le Pacifique depuis des décennies, mais sa fréquentation a explosé ces cinq dernières années, signalent les forces de l’ordre et les experts en sécurité que nous avons rencontrés. Depuis 2014, l’Australian Federal Police (AFP) a participé à la saisie d’environ 7,5 tonnes de cocaïne, transportée sur de petites embarcations de type voiliers navigant dans la région en direction du pays-continent.
En 2004, 120 kilos de cocaïne ont été interceptés sur une plage du Vanuatu, « un record historique pour cette petite nation du Pacifique », notaient alors les services de l’Australian Federal Police. Neuf ans plus tard, la police effectuait dans le même pays une saisie six fois plus importante.
Depuis 2016, la Polynésie française a enregistré six grosses saisies de drogue. En 2017, un voilier a été intercepté au large de la Nouvelle-Calédonie avec 1,464 tonne de cocaïne cachée dans sa coque, tandis qu’un autre était arrêté devant la côte est de l’Australie avec plus de 1,4 tonne à son bord. Des cargaisons qui, chacune, valaient environ 178 millions d’euros.
« Les saisies augmentent, c’est que le trafic augmente », résume Andreas Schloenhardt.
Addiction, violence, criminalité, corruption
C’est qu’il y a une conjugaison de facteurs délétères. La production de cocaïne tourne à plein régime. Parallèlement, Australiens et Néo-Zélandais sont pris d’une passion dévorante pour la poudre blanche, au point qu’ils ont le plus fort taux de consommation par habitant au monde. Et ce marché est extrêmement lucratif, puisque nulle part ailleurs dans le monde le consommateur ne paie sa coke aussi cher, autour de 300 dollars australiens le gramme [soit 185 euros, contre 80 à 85 euros en France en 2016-2017 selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies].
La drogue arrive en Australie par divers moyens de transport : cargos, bateaux de croisière, avions. En décembre 2018, un steward fidjien a été arrêté alors qu’il tentait de faire sortir de la cocaïne de son pays, et en mars dernier, la police australienne a interpellé deux hommes, dont un employé de l’aéroport de Sydney, appartenant à un réseau de trafic de métamphétamine. Mais entre le durcissement des contrôles dans le transport aérien et aux douanes aéroportuaires de nombreux États du Pacifique, et le faible nombre de vols directs reliant l’Amérique latine à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande, l’option maritime devient la solution la plus rentable et la plus prisée des trafiquants.
« Pour son malheur, le Pacifique se retrouve au milieu de tout ça », déplore Tevita Tupou, directeur des opérations à l’Oceania Customs Organisation [organisation douanière d’Océanie]. Certains pays de la zone voient ainsi s’accroître les problèmes d’addiction à la cocaïne et aux métamphétamines, mais aussi les violences entre bandes, la criminalité et la corruption dans la police.
Le commissaire Brett Kidner, qui fut l’officier de liaison de l’AFP pour le Pacifique de 2016 à début 2019, dit avoir vu “les comportements changer” à l’égard de la drogue dans la région, rien que le temps de son stationnement à Suva, la capitale des Fidji.
« Au départ, ils y voyaient surtout un problème purement australien et néo-zélandais, qui ne faisait que transiter chez eux. Quand je suis parti, ils commençaient à voir augmenter la consommation chez eux. Aux Fidji, à Tonga, aux Samoa, j’ai vraiment vu la consommation augmenter. »
Le trafic international à travers le Pacifique n’est cependant pas seul en cause dans l’addiction croissante des Fidjiens, souligne Sitiveni Qiliho, le chef de la police fidjienne, que nous avons interrogé à bord d’une vedette patrouillant au large de la côte ouest de l’île principale. L’essor du tourisme et la hausse du niveau de vie dans le pays jouent aussi leur rôle.
« Quand les trafiquants réceptionnent leur cargaison, il n’est pas rare qu’ils paient en marchandise, et ces quelques kilos partent sur le marché – c’est ainsi que la consommation augmente », explique Sitiveni Qiliho.
Des petits pays mal préparés à faire face
Ian Collingwood, qui a vécu presque toute sa vie aux Fidji, est lui-même toxicomane. Pour lui, cet État insulaire a un problème de drogue “bien visible et très sérieux”, qui n’a plus rien de “balbutiant”. “À cent mètres d’ici, vous pouvez acheter de la métamphétamine et de la cocaïne, comme ça, sans problème”, nous dit-il dans un café très couru de Nadi, la troisième agglomération de Fidji, par une après-midi ensoleillée.
« Et avec la drogue est apparue « une violence terrible, terrible », poursuit-il.
Comme dans tous les pays, tout en haut de la chaîne, il y a des trafiquants qui sont des hommes dangereux, de très, très sales types, sans aucun scrupule, raconte Ian Collingwood. Ils kidnappent et abandonnent des gens en pleine cambrousse, ils envoient des gars vous exploser les genoux ou autre chose, ordonnent des attaques à l’acide, des assassinats. Tout ça, c’est récent. Au cours d’une période s’étalant sur les 12 à 24 derniers mois, je dirais qu’il y a eu six, sept ou huit morts à cause de la drogue. »
Un phénomène auquel ces petits pays de la région Pacifique sont mal préparés.
La république des Fidji, par exemple, ne tient aucune statistique sur la consommation de drogue et les toxicomanies ? ; il n’y a dans l’archipel ni centre de désintoxication, ni dispensaire distribuant de la méthadone, aucun médecin addictologue ni réunion de narcotiques anonymes. À en croire Ian Collingwood, les addictions ne sont même pas considérées comme des pathologies médicales. Les personnes dépendantes nécessitant un traitement finissent à l’hôpital psychiatrique de St Giles, à Suva : là, près de 20 % des patients admis entre mai 2017 et avril 2018 étaient traités pour abus de substances toxiques, le plus souvent une addiction aux métamphétamines.
« Personne ne s’est jamais désintoxiqué là-dedans, ça n’arrive pas, lâche Collingwood. Je connais des tas de gens qui veulent s’en sortir, ils ne savent tout simplement pas comment s’y prendre. »
« Par où on commence ? »
Dans les bureaux de l’Oceania Customs Organisation, à Suva, tout un mur est occupé par une immense carte en couleurs du Pacifique, qui va de l’ouest à l’est de l’Australie et des Palaos jusqu’à la Polynésie française. De quoi, pour Tevita Tupou, nous aider à mesurer l’ampleur de la tâche qui incombe aux services de police et de justice de la région, engagés selon lui dans un combat “façon David contre Goliath” face à une criminalité qui ne manque ni de moyens financiers ni d’ingéniosité.
« Le Pacifique couvre un tiers de la surface de la Terre », dit-il en désignant le planisphère, puis il énumère les problèmes : « Des frontières poreuses, et des frontières maritimes de surcroît, un grand étalement géographique, des moyens limités : voilà dans quel environnement nous travaillons. Par où on commence ? » Tevita Tupou en rirait presque – « Mais c’est sans doute le combat de notre génération : si nous perdons, nous sommes finis.
Pour lui, la République des Fidji et ses voisins ne se débarrasseront plus des problèmes liés aux drogues dures : le ver est dans le fruit.
Nous n’éradiquerons pas la drogue, car il y aura toujours de la demande, et toujours de l’argent à gagner dans le trafic, mais nous pouvons leur mettre des bâtons dans les roues. Compliquer la tâche des criminels, voilà notre objectif. »
Kate Lyons
Lire l’article original
SOURCE
THE GUARDIANLondreswww.theguardian.com
Source : Courrier International
====::====
Police. Aux Philippines, l’épicentre de la guerre contre la drogue se déplace
Publié le 08/07/2019

Des militants demandent “l’arrêt des tueries” dans le cadre de la lutte contre la drogue menée par Rodrigo Duterte, à Manille le 23 juillet 2018. PHOTO / REUTERS / Erik de Castro
Aux Philippines, la province de Bulacan, à proximité de la capitale, paye le prix fort dans la guerre contre la drogue, selon un rapport établit par Amnesty International.
La province de Bulacan, proche de la capitale des Philippines (Manille), est devenue selon l’organisation Amnesty International, le “plus sanglant champ de la mort” dans la guerre contre la drogue mise en œuvre par le gouvernement du président Rodrigo Duterte, note The Philippines Daily Inquirer.
Selon l’organisation, Bulacan connaît une augmentation du nombre de tués depuis un an. Une augmentation qui, selon l’association des droits de l’homme, pourrait être liée au transfert d’un certain nombre d’officiers de police impliqués dans des assassinats dans la capitale.
Des pauvres et des marginalisés pris pour cibles
Amnesty International a enquêté à Bulacan sur 20 affaires de drogues dans lesquelles 27 personnes ont été tuées. L’enquête indique que la majorité des personnes tuées sont pauvres ou marginalisées.
Amnesty International relève que le nouveau chef de la police provinciale est Chito Bersaluna. En août 2017, il était responsable du district de Manille, où a été tué un adolescent de 17 ans, Kian delos Santos.
Dans cette affaire, des enregistrements vidéo avaient permis de contredire la version de la police, qui plaidait la légitime défense. La vidéo montrait que l’adolescent avait été exécuté froidement. Trois policiers subalternes ont été jugés et condamnés à une peine de prison à perpétuité. Chito Bersaluna n’a eu, déplore Amnesty International, qu’une simple sanction administrative.
La sénatrice Leila de Lima a d’ailleurs demandé que le Sénat ouvre une enquête sur “l’augmentation soudaine du nombre de suspects tués dans des opérations de police contre la drogue”, dans la région de Central Luzon, où est située la province de Bulacan, précise le quotidien philippin.
Selon les données de la police, 542 suspects ont été tués dans les 7 provinces de la région de Central Luzon, ce qui, aux yeux de la sénatrice, fait de la région le “nouvel épicentre des assassinats”.
À titre de comparaison, la sénatrice fait observer que ce bilan est près de deux fois plus lourd que celui des 285 personnes tuées dans la capitale l’année dernière.
À quand une enquête des Nations unies ?
Amnesty International demande que les Nations unies et le Conseil des droits de l’homme se saisissent du dossier de la guerre contre la drogue conduite aux Philippines depuis la prise de fonction du président Rodrigo Duterte en juin 2016.
Selon les autorités, plus de 6?500 personnes ont été tuées dans les opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. Un chiffre sous-estimé selon les organisations de droits de l’homme et les enquêtes conduites par plusieurs journalistes, qui évaluent à plus de 20.000 le nombre de personnes tuées dans des opérations policières.
====::====
États-Unis. Comment le secteur pharmaceutique a rendu l’Amérique accro aux opioïdes
Publié le 13/08/2019
Des prescriptions d’oxycodone dans le pôle médical de l’Université de Washington à Seattle, en 2012. Stuart Isett/The New York Times
Une série de procès livre une image accablante de grandes sociétés prêtes à tout pour encourager la prescription d’antidouleurs. La quête du profit a fini par causer la plus grande épidémie de drogues de l’histoire américaine.
Lorsque Mike Hunter, le procureur général de l’Oklahoma, a décidé d’engager des poursuites contre l’une des plus grosses entreprises américaines, il a tenu à préciser qu’il n’était pas hostile aux multinationales. « Je suis républicain, conservateur, mais même si je crois au capitalisme et à la loi du marché, ça ne veut pas dire que je doive fermer les yeux quand des entreprises font du mal aux gens », a-t-il plaidé devant le tribunal.
Cet homme politique, qui a pourtant fait du lobbying pour le secteur bancaire et qui a pris le parti de compagnies pétrolières contre les réglementations environnementales, non seulement demande 17 milliards de dollars à une multinationale mais l’accuse également de tuer des gens. C’est dire que quelque chose ne tourne vraiment pas rond.
“Sournoise, cynique et trompeuse”
À la mi-juillet, le procès où Mike Hunter a affronté le géant de l’industrie pharmaceutique Johnson & Johnson s’est achevé au bout de deux mois. Les débats ont apporté des précisions sur la part de responsabilité des laboratoires dans la crise des opioïdes, qui a fait plus de 400 000 morts aux États-Unis. Le procureur général de l’Oklahoma a accusé l’entreprise d’avoir agi de manière “sournoise, cynique et trompeuse” pour multiplier les ventes des antidouleurs opioïdes, et d’être une des responsables de la plus grande épidémie de dépendance aux drogues de l’histoire américaine – qui s’est révélée particulièrement lucrative pour les labos. L’industrie pharmaceutique a travaillé de concert pour convaincre le monde médical, les chercheurs, les organismes de régulation fédéraux et la classe politique des bienfaits des opioïdes.
Quelques jours après la plaidoirie de Mike Hunter, un nouveau rebondissement a révélé que d’autres laboratoires pharmaceutiques s’étaient engouffrés dans ce secteur, dont les profits s’élèvent aujourd’hui à 8 milliards de dollars par an.
Dans l’Ohio, un juge fédéral a présenté des informations secrètes prouvant que plusieurs entreprises avaient inondé le pays de plus de 75 milliards de comprimés d’opioïdes en à peine plus de six ans, y compris les régions déjà violemment touchées par l’épidémie. Selon ces données, il est clair que les laboratoires et les distributeurs pharmaceutiques ont continué de multiplier les livraisons d’opioïdes alors que le nombre de morts par overdose crevait le plafond et que l’agence américaine de lutte antidrogue (DEA) avait tiré la sonnette d’alarme.
Certaines de ces entreprises sont immédiatement identifiables par l’Américain moyen, comme les supermarchés Walmart ou la chaîne de pharmacies CVS.
D’autres font partie des plus importantes du pays, mais ne sont connues que du monde des affaires. C’est le cas du distributeur pharmaceutique McKesson, dont le directeur général était le mieux payé des États-Unis alors que la production d’opioïdes battait son plein. Ces entreprises ont fait d’immenses bénéfices en submergeant le pays d’antalgiques.
Dans l’Ohio, le procès a également permis de rendre publique une série de courriels particulièrement choquants montrant le mépris total des laboratoires pour les conséquences dramatiques de l’épidémie.
Dans son ensemble, ce procès dresse un portrait accablant d’une partie du secteur pharmaceutique qui a exercé une très forte influence sur la pratique de la médecine sans s’inquiéter d’un nombre de morts gigantesque.
Concurrentes mais aussi partenaires
Jusqu’à récemment, c’était surtout Purdue Pharma, propriété de certains membres de la famille Sackler, qui était au centre de la polémique, l’opioïde très puissant qu’elle produit, l’OxyContin, ayant joué un rôle majeur dans la crise sanitaire. L’entreprise a multiplié ses ventes au début des années 2000 par le biais d’une campagne de publicité très efficace qui visait à encourager les professionnels de santé à prescrire davantage d’opioïdes afin d’en faire le traitement par défaut des douleurs chroniques.
Mais Purdue Pharma n’est pas la seule en tort, comme l’a révélé le procès Johnson & Johnson. L’équipe de Mike Hunter a prouvé que le service marketing de l’entreprise s’était emparé d’une partie du marché d’oxycodone avec les mêmes méthodes de vente agressives que celles de Purdue. Johnson & Johnson s’adressait notamment aux médecins qui prescrivaient déjà des opioïdes en grande quantité, surtout de l’OxyContin.
Dans le même temps, l’entreprise travaillait main dans la main avec Purdue afin de faire pression sur le monde médical, les organismes de surveillance fédéraux et la classe politique et ainsi encourager la prescription d’opioïdes en masse, à une échelle inédite. Les deux sociétés étaient concurrentes mais aussi alliées.
Elles ont menti sur les effets des drogues en falsifiant des articles scientifiques pour affirmer que les risques d’addiction étaient inférieurs à 1 %. Les fabricants ont financé des études qui abondaient en leur sens ainsi que des formations médicales qui privilégiaient les opioïdes comme traitement par défaut contre la douleur.
Un choix conscient de tout le secteur
Les laboratoires contribuent largement au budget de la FDA [l’agence américaine des denrées alimentaires et des médicaments], en payant des frais pour les tests avant mise sur le marché. Certains estiment que les deux entités entretiennent des rapports trop étroits, et des employés de la FDA l’accusent de servir les intérêts des grands groupes pharmaceutiques.
Cette affaire n’est pas le fait d’une poignée d’entreprises véreuses : c’était un choix conscient de tout le secteur. Certes, Purdue a été la première à en récolter les fruits. En 2000, son chiffre d’affaires pour l’OxyContin s’élevait à plus de 1 milliard de dollars par an. Les ventes ont ensuite doublé en quelques années et n’ont cessé de grimper.
[Courant juillet], pourtant, les données publiées par l’agence américaine de lutte antidrogue ont montré que d’autres entreprises pharmaceutiques avaient suivi le mouvement et généralisé l’usage des opioïdes génériques partout dans le pays. L’une d’entre elles, Mallinckrodt, représentait plus d’un tiers du marché de l’oxycodone et de l’hydrocodone avec 29 milliards de comprimés vendus entre 2006 et 2012.
Cette société figure aussi dans les communications du tribunal de l’Ohio révélées par le Washington Post.
“Qu’ils continuent à manger”
Elles contiennent notamment un courriel envoyé en 2009 par Victor Borelli, responsable grands comptes chez Mallinckrodt, à Steve Cochrane, directeur des ventes chez KeySource Medical, distributeur pharmaceutique. Il l’informait qu’une cargaison d’oxycodone était en route. Steve Cochrane a répondu :
« Envoyez, envoyez ! Ne vous arrêtez pas ! Ça part tellement vite qu’on croirait que les gens y sont accros. Ah mais c’est le cas, en fait… »
Ce à quoi Borelli réplique : « Qu’ils continuent à en manger comme si c’était des Doritos. On en fabriquera encore plus. »
Des courriels similaires ont été dévoilés lors des procès de Purdue Pharma et de Johnson & Johnson.
Les entreprises ont affirmé que ces propos n’engageaient que leurs auteurs. Mais ils sont peut-être une expression plus sincère de leur attitude face à l’épidémie des opioïdes que les campagnes de communication de Purdue et de Johnson & Johnson, qui cherchent à s’exonérer de leurs responsabilités.
Chris McGreal
Source : THE GUARDIAN Londres www.theguardian.com
====::====
L’héroïne met le cap sur l’Afrique
C’est en Afrique que la consommation d’héroïne augmente le plus rapidement. Délaissant la route des Balkans, les trafiquants acheminent leur marchandise à destination de l’Occident en passant par le continent africain. Avec des conséquences sanitaires terribles.
Alizea Smit (le nom a été changé) est assise sur une caisse en plastique devant son étal de fruits et légumes à Wynberg, une banlieue du Cap, en Afrique du Sud. Beaucoup de clients viennent acheter ses oranges et ses avocats. C’est un endroit commode car le dealer d’héroïne d’Alizea est posté à quelques mètres de là.
Elle se drogue depuis six ans, et elle achète trois ou quatre doses par jour à 30 rands [1,90 euro] la pièce. Si elle ne vend pas assez de produits frais pour entretenir sa dépendance, elle se prostitue le soir. « L’héroïne, c’est ce qu’il y a de pire. C’est la première drogue dont je n’arrive pas à me sevrer », explique-t-elle.
Encore récemment, les héroïnomanes étaient rares en Afrique. Dans les années 1980 et 1990, les accros se trouvaient principalement dans les zones touristiques, comme Zanzibar [en Tanzanie], ou dans des enclaves où la population était blanche et branchée, notamment à Johannesburg.
Mais depuis 2006, la consommation d’héroïne a augmenté plus rapidement en Afrique que sur tout autre continent, selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Le commerce de cette substance a des conséquences terribles, sur la santé publique mais aussi sur la vie politique.
Route de la poudre
La progression de l’héroïne en Afrique reflète notamment une augmentation de l’offre à l’échelle mondiale. Les talibans ayant renforcé leur emprise dans certaines régions d’Afghanistan, où 85 % du stock mondial d’héroïne est fabriqué, une plus grande partie de ce pays s’est lancée dans la culture du pavot. En 2017, la production d’opium a augmenté de 65 %, atteignant ainsi 10 500 tonnes, un record selon l’ONUDC au vu de ses données collectées depuis 2000.
Non seulement la quantité d’héroïne produite est en hausse, mais la part du trafic passant par l’Afrique augmente également. La route dite des Balkans, qui traverse l’Iran, la Turquie et le sud-est de l’Europe, est la principale voie d’acheminement vers l’Occident. Mais depuis dix ans, le transport de stupéfiants par cette route est plus difficile : la Turquie protège plus étroitement ses frontières en raison de la guerre en Syrie, et les pays européens tentent d’endiguer le flux de réfugiés.
Par conséquent, un plus grand nombre de récoltes d’opium sont transportées via l’hémisphère Sud. Parfois qualifié de “route de la poudre”, cet itinéraire part de l’Afghanistan en direction de la côte du Makran, dans le sud du Pakistan, où les stocks sont chargés sur des boutres, navires traditionnels arabes aux voiles triangulaires. (Une partie de l’héroïne est aussi acheminée illégalement dans des porte-conteneurs.)
Tout au long de l’année, exception faite de la mousson, les boutres traversent l’océan Indien et s’amarrent au large de la Somalie, du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique. Des embarcations plus petites collectent les produits, les débarquent sur des plages, dans des criques ou dans des zones portuaires industrielles.
La marchandise est ensuite transportée par la route vers l’Afrique du Sud, d’où elle est expédiée par bateau ou par avion vers l’Europe ou l’Amérique, selon un rapport de Simone Haysom, Peter Gastrow et Mark Show, de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (Gitoc). Le chemin est plus long que la route des Balkans, mais les marges dégagées par ce trafic sont telles qu’elles compensent largement ce détour.
Les autorités se montrent globalement incapables d’endiguer ce trafic. Depuis 2010, une force navale multinationale dirigée par les États-Unis a réalisé plusieurs saisies dans la mer d’Arabie, mais ces militaires luttent principalement contre le terrorisme et ne cherchent pas à mener des coups de filet. L’héroïne peut être saisie au motif que les ventes de drogue financent les talibans, mais la mission de cette force n’est pas d’arrêter les contrebandiers.
Quant aux prises sur le continent africain, elles sont “extrêmement rares”, note Shanaka Jayasekara, de l’ONUDC. Il est possible que la police ne s’en préoccupe même pas, car les autorités et leurs soutiens politiques sont souvent de mèche avec les trafiquants.
L’effet terriblement néfaste du commerce d’héroïne sur le paysage politique est manifeste au Mozambique. Il est difficile de vérifier les données, mais l’héroïne pourrait être la première ou la deuxième denrée d’exportation dans ce pays (après le charbon), estime l’analyste Joseph Hanlon, de la London School of Economics (LSE).
Au Mozambique, le trafic est sous le contrôle de familles puissantes, et il est secrètement réglementé par le Front de libération du Mozambique (Frelimo), parti au pouvoir autrefois d’obédience marxiste. Dans un hôtel de Nampula, dans le nord du pays, l’employé d’un baron de la drogue explique la relation entre les contrebandiers et l’État : en échange de financements politiques et de pots-de-vin, le Frelimo évite aux trafiquants d’être arrêtés.
Le parti émet aussi des autorisations qui leur permettent d’importer et d’exporter des biens sans que les cargaisons soient fouillées dans le port de Nacala. Dans un cas présumé, un contrebandier a importé des centaines de motos grâce à l’imprimatur du Frelimo, et toutes avaient un réservoir rempli d’héroïne.
Au Mozambique, aucune figure éminente du narcotrafic n’a été arrêtée. Les saisies de la police sont extrêmement rares ; les agents du renseignement sud-africain se plaignent d’ailleurs que leurs homologues mozambicains bloquent les enquêtes. Quant aux bailleurs de fonds internationaux du Mozambique, ils rechignent à aborder le sujet ; les grands manitous du développement se soucient peu de la criminalité.
Rivalités
C’est pourtant une vision à court terme. Un rapport publié en novembre dernier par l’analyste Simone Haysom laisse entendre que les confiits liés à l’héroïne et à d’autres commerces illicites alimentent [depuis 2017] une insurrection armée dans l’extrême nord du pays, où se trouvent des gisements considérables de gaz naturel.
Le narcotrafic est aussi néfaste pour l’Afrique du Sud, qui sert de base de transit pour les cargaisons, car le pays a de bonnes infrastructures et une monnaie faible (ce qui rend bon marché certains services, par exemple ceux d’avocats). Contrôler le marché de l’héroïne suscite des rivalités entre chefs de gang, ce qui a entraîné une forte hausse des homicides au Cap.
L’Afrique du Sud est aussi le pays où les effets du trafic d’héroïne sur la santé publique sont les plus brutaux. Comme les intermédiaires sont généralement rémunérés en drogue, la croissance du marché de gros se solde par une plus grande quantité d’héroïne en circulation au niveau local. Une armée de dealers est alors prête à recruter des clients.
Le dealer d’Alizea, un Tanzanien de 35 ans qui s’appelle Juma, décrit sa méthode. Il offre aux nouveaux usagers un “kit de démarrage”, et il récompense les clients récurrents de leur fidélité : une dose (d’une valeur de 30 rands) est offerte pour cinq doses achetées. Un “kit de relance” est vendu 500 rands [32 euros], et il en garde 250 rands après avoir versé à des gangs une “taxe” de protection.
Le deal est une activité risquée, mais Juma explique que ça vaut mieux que sa vie sur Zanzibar, où il touchait l’équivalent de 2 dollars par jour pour réparer des poteaux téléphoniques. Ce salaire n’était pas suffisant pour faire vivre sa femme et ses deux enfants, c’est pourquoi il a émigré en Afrique du Sud. Il confie en soupirant : « Putain, je t’avoue que c’est pas tous les jours facile. »
Il y a peu de données sur l’héroïnomanie en Afrique du Sud. Plus de mille personnes sont en désintox, contre quasiment zéro il y a vingt ans, mais ce chiffre correspond à une petite fraction des consommateurs. Selon une estimation, 75 000 personnes prennent de l’héroïne par injection, soit 0,2 % des adultes sud-africains.
L’injection n’est toutefois qu’un mode de consommation. Beaucoup fument ce stupéfiant sous la forme d’un cocktail toxique composé de lessive en poudre, de somnifères et de métamphétamine. Certains font le choix du bluetoothing : une personne se prélève du sang après un shoot, puis elle le transfuse dans les veines de quelqu’un d’autre. Dans un pays où le sida demeure répandu, cette pratique est incroyablement risquée.
Le pasteur Craven Engel dirige près du Cap un centre de désintox appelé Camp Joy [“camp de la joie”], à destination de toxicomanes aliés à des gangs : selon lui, il ne fait aucun doute que l’héroïne est actuellement “la drogue à la mode”. Depuis cinq ans, elle est plus populaire que la métamphétamine.
Et les anciens drogués sont d’accord. Pour beaucoup d’entre eux, prendre de l’héroïne était un moyen d’effacer les souvenirs violents liés aux disputes pour contrôler les quartiers. Un membre de gang explique : « J’avais besoin de cette drogue pour soulager ma conscience. »
Tant que la route du sud sera privilégiée, la demande d’opium pour apaiser les âmes a peu de chances de diminuer.
Publié le 31 janvier
====::====
Repères
OPIOÏDES, UNE CRISE MONDIALE
En 2017, 53 millions de personnes ont consommé des opioïdes, une hausse de 56 % par rapport à 2016, selon l’ONU. Parmi ces consommateurs, 29,2 millions ont pris de l’héroïne ou de l’opium (+ 50% par rapport à 2016). Cette forte hausse s’explique par la prise en compte récente, dans les statistiques, d’études concernant deux pays très peuplés, l’Inde et le Nigeria. L’Amérique du Nord reste la zone la plus touchée par cette crise sanitaire avec, en 2017, 4% de la population qui consommait des opioïdes et 47 000 décès par overdose de ces drogues (dont la moitié imputés aux fentanyl). Les États-Unis sont toujours le principal marché pour le fentanyl, mais le trafic s’étend au niveau mondial. En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, c’est un autre opioïde synthétique qui fait des ravages : le tramadol.
Dans son rapport 2019 sur les drogues, l’ONU lance un cri d’alarme à propos de l’explosion de l’usage non médical du tramadol dans ces régions. Les opioïdes sont responsables de deux tiers des décès dus à l’usage de stupéfiants.
====::====
Une consommation en très forte hausse
+ 30 % DE CONSOMMATEURS DE DROGUE DANS LE MONDE
« En 2017, environ 271 millions de personnes, soit 5,5 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans, avaient consommé de la drogue l’année précédente. » Ils étaient 210 millions en 2010, constate le rapport 2019 de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.
COCAÏNE : PRODUCTION ET SAISIES RECORDS…
La culture de coca et la fabrication de cocaïne ont atteint des niveaux records en 2017 (1 976 tonnes de cocaïne pure, soit 25 % de plus qu’en 2016). C’est notamment en Colombie, qui assure quelque 70 % de la production mondiale, que la production est repartie à la
hausse malgré les tentatives du gouvernement de réduire les zones de culture. « Après l’accord de paix avec les Farc, en 2016, précise le rapport de l’ONU, les cultures se sont déplacées. »HÉROÏNE : EN LÉGER RECUL
L’Afghanistan reste le premier pourvoyeur mondial d’opium (loin devant la Birmanie et le Mexique), même si, en raison de la sécheresse, la culture du pavot a reculé en 2018 (– 17 %). Mais la récolte 2018 est la deuxième par son ampleur parmi celles jamais enregistrées, selon l’ONU, et en dix ans, la super cie des terres consacrées à la culture de l’opium a augmenté de 60 %. Si la route des Balkans a pu être délaissée, elle demeure le canal principal du trafic d’héroïne. En 2017, les saisies d’héroïne et de morphine dans les Balkans ont représenté 47 % des saisies mondiales.
En Amérique du Sud, des frontières poreuses
La cocaïne issue de la forêt péruvienne connaît des cheminements complexes. Elle transite par la Bolivie, se dirige vers le Brésil, le Paraguay et l’Argentine, avant de poursuivre vers l’Europe et les États-Unis. À la source du trafic, la cocaïne péruvienne est fabriquée dans les laboratoires clandestins d’une profonde vallée du Pérou baignée par les fleuves Apurímac, Ene et Mantaro. La poudre blanche emprunte ensuite des routes diversifiées, au tracé souvent modifié, et des modes de transport tout aussi multiples qui déconcertent les autorités, dont le travail est rendu diffcile par mille kilomètres de frontière avec la Bolivie voisine, “pays de transit”, explique le quotidien bolivien La Razón.
Le moyen de transport privilégié reste l’avion privé, affrété depuis la Bolivie vers le Pérou. De là, les narcos jouent au chat et à la souris avec les forces de l’ordre. Depuis la Bolivie, des ponts aériens d’abord, puis des parcours en camion ou à pied leur permettent d’atteindre le Paraguay, le Brésil, l’Argentine… « Les narcotrafiquants ont cessé de recourir à des trajets directs en avion de la Bolivie vers le Brésil, car la police brésilienne a introduit des radars détectant les vols illégaux », constate une enquête du site multimédia bolivien Eju.tv. Mais le Brésil peut aussi être relié par sa partie amazonienne. Désormais, poursuit le site, les « narco-avions sont capables de se ravitailler en vol, ce qui leur permet d’atteindre n’importe quel point du Chaco transnational [une région de triple frontière entre la Bolivie, l’Argentine et le Paraguay] et le trajet se termine par voie terrestre jusqu’à Ciudad del Este (Paraguay), Puerto Iguazú (Argentine) ou Foz do Iguaçu (Brésil) ».
Le Paraguay est récemment devenu un point focal du transit de la marchandise vers l’Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient, détaille Eju.tv. La drogue embarque, par exemple, sur des navires qui exportent du soja.
====::====
Repères
Toutes les méthodes sont bonnes
Qui a dit que les mules n’avaient plus la cote ? Au début du mois d’août, une Colombienne a été arrêtée par la police à l’aéroport de Bogota avec 780 grammes de cocaïne liquide… implantés entre “la peau et le muscle” de sa cuisse, relate le magazine américain Newsweek. Une technique astucieuse, étant donné l’incapacité des scanners corporels à identifier le contenu d’un implant. Moins subtil, un ressortissant colombien a été intercepté à l’aéroport de Barcelone, mi-juillet, trahi par une perruque négligemment posée sur son crâne. En dessous, 30 000 euros de cocaïne. “Les technologies modernes de détection des chargements illégaux de drogue ont obligé les trafiquants à innover”, appuie le site argentin Infobae.
« Véhicules frappés de logos institutionnels, voyages organisés et compétitions cyclistes, camouflage à l’aide d’agents chimiques, recours aux drones et aux aliments font partie des nouvelles stratégies identifiées » par les forces de l’ordre en Colombie. Exemple typique, des narcotrafiquants contactent « une agence touristique afin qu’elle invite un groupe à venir passer des vacances très bon marché en Équateur, au motif que le propriétaire de l’entreprise offre un voyage tous frais payés à un bus entier car il avait rempli ses objectifs économiques. Au cours du trajet, le bus ‘tombe en panne’ et c’est à ce moment que la drogue est chargée, puis le bus repart et traverse la frontière avec l’Équateur. Le groupe poursuit son itinéraire puis rentre en Colombie avec l’argent tiré de la vente de la marchandise. »
Dans certains cas, la méthode employée paraît plus mystérieuse, en témoignent les paquets de cocaïne retrouvés sur une plage néo-zélandaise mercredi 8 août.
D’une valeur totale de 1,8 million d’euros, la cargaison a certainement été jetée par-dessus bord ou bien, deuxième hypothèse, s’est détachée de son point d’amarrage, où elle avait été laissée avant d’être récupérée par un plus petit bateau censé la transporter jusqu’à la terre ferme. En matière de trafic, comme le note le lieutenant Wilson Silva, de la police colombienne, « ’improbable est devenu la nouvelle norme ».
====::====
Un air de déjà-vu dans les Balkans
Les changements géopolitiques au Moyen-Orient ont réactivé le trafic de drogue dans le Sud-Est européen. S’appuyant sur la corruption endémique de la police et de la justice, les narcotrafiquants locaux en tirent de juteux profits.
— Vecernji List Zagreb
En été 2018, quatre ressortissants croates et un Monténégrin se sont rencontrés pour échafauder l’affaire de leur vie. Il était question de trafic de drogue, plus précisément de marijuana. Tout d’abord, il leur fallait de bons contacts avec le milieu et des camions adaptés à ce type de trafic. Le Monténégrin fut chargé de contacter ses correspondants albanais – l’Albanie étant, comme on l’enseigne dans les écoles de police, le paradis du narcotrafic. La marijuana y est cultivée aux quatre coins du pays, c’est un business familial. La police ne peut pas s’infiltrer dans les clans familiaux, elle n’ose même pas entrer dans les villages qui vivent des plantations de marijuana.
Dotés d’un bon sens des affaires, les personnages de notre histoire ont négocié avec leurs partenaires albanais l’achat de 500 kilos de marijuana – et bénéficié d’une remise en regard de la quantité achetée. Un kilo de marijuana se vendant au marché noir croate 20 000 kunas [3 000 euros], de juteux profits étaient garantis. Une fois le marché conclu, il restait à transporter la drogue. Les hommes trouvèrent des camions, la drogue y fut dissimulée sous des fruits et légumes ou du matériel de construction. L’affaire a marché comme sur des roulettes de l’été 2018 à avril 2019. Les camions chargés de marijuana partaient de l’Albanie pour le Monténégro, puis continuaient leur route vers la Croatie et l’Europe de l’Ouest. Avant de partir à travers le continent, la drogue était stockée dans plusieurs entrepôts situés à Varazdin [nord-ouest de la Croatie]. Une partie était destinée à la vente en Croatie, tandis que l’autre était reconditionnée pour être écoulée en Allemagne. Et ce fut là l’erreur !
Panneaux décoratifs
Pour une raison ou pour une autre, fort probablement grâce aux informateurs infiltrés dans le milieu, les camions et les entrepôts ont attiré l’attention des services des douanes. Une inspection des lieux a permis à la police de Varazdin d’y trouver 500 kilos de marijuana et une certaine quantité d’amphétamines, puis de démanteler du même coup une chaîne de trafic apparemment bien rodée. Il s’agissait d’une des plus grandes saisies de drogue de ces dernières années.
Parallèlement, à Belgrade, la police serbe préparait dans le plus grand secret une opération contre le clan criminel Amerika, qui contrôlait la vente d’héroïne dans la région. On suspectait ce clan, connu dans les années 1990 pour ses liquidations mafieuses et quelques assassinats politiques pour le compte de Slobodan Milosevic [président serbe pendant la guerre de 1991-1995], d’être l’un des plus grands fournisseurs d’héroïne en Europe. Après avoir planifié minutieusement l’opération, la police serbe est entrée en action début mars. Les membres du clan se sont fait prendre littéralement les mains dans le pot de confiture dans un restaurant belgradois, en possession de 2 kilos d’héroïne. Serbes, Albanais et Turcs figuraient parmi les personnes interpellées. L’enquête a dévoilé que l’héroïne avait été introduite en Serbie dissimulée dans des panneaux décoratifs transportés par une ressortissante bulgare. La drogue provenait d’Albanie, d’où elle passait en contrebande en Turquie et en Bulgarie, pour atterrir en Serbie, d’où elle devait continuer vers l’Europe de l’Ouest.
Depuis plusieurs années, on évoquait la “route des Balkans” dans le contexte des migrations illégales plutôt que dans celui de la drogue. Or les deux opérations des polices croate et serbe ainsi que l’importance des saisies montrent bien que cette route a été réactivée pour la drogue. En 2018, la police croate a saisi 4,7 tonnes de marijuana, soit 66,6 % de plus qu’en 2017. La majorité de cette drogue a été retrouvée au poste-frontière de Karasovici [à la frontière du Monténégro] ou à celui de Bajakovo, à la frontière avec la Serbie. En revanche, la police a saisi moins de cocaïne : 109 kilos en 2018, soit presque cinq fois moins qu’en 2017. Les saisies d’héroïne ont également accusé une baisse, de 80 % (passant de 26,8 kilos en 2017 à 5,6 kilos en 2018). Les chiffres de la police montrent bien que le marché de la drogue est très dynamique et que les producteurs et les distributeurs s’adaptent rapidement à la situation géopolitique et aux besoins des consommateurs.
L’ouverture d’un bureau de la DEA [Drug Enforcement Administration, l’agence américaine de lutte contre le trafic de drogue] à Zagreb en 2016 a sans doute aidé les polices de la région à mieux suivre les circuits de la drogue et à arrêter les revendeurs et distributeurs. Car cette agence dispose de moyens beaucoup plus perfectionnés de traque et d’infiltration des clans de la drogue.
Ivana Jakelic
====::====
Publié le 27 avril
Source : VECERNJI LIST
Zagreb, Croatie
Le “Journal du soir” est un quotidien populaire et généraliste de Zagreb, dont le premier numéro est paru le 1er juillet 1959. Il appartient aujourd’hui à l’entreprise de presse Styria AG.
Contexte
LA GUERRE DES NARCOCLANS MONTÉNÉGRINS ET SERBES
Depuis 2014, la guerre entre les narcoclans monténégrins de Skaljari et de Kavaci (nommés d’après deux localités dans la baie de Kotor) fait rage. Elle a été déclenchée après la disparition d’un chargement de 200 kilos de cocaïne dans le port de Valence, en Espagne. Les deux clans s’accusent mutuellement de l’avoir volé. Depuis, les fusillades et les liquidations sont presque quotidiennes dans les rues des villes monténégrines et serbes, note le quotidien Blic, de Belgrade.







