La loi (de 1970) qui fonde l’intervention publique dans le domaine des drogues en France a plus de 52 ans. La politique menée sur cette base est devenue totalement obsolète au regard de l’évolution de la situation actuelle [1]
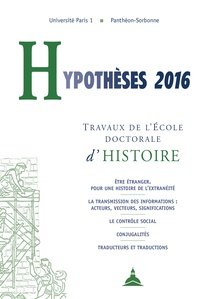 Le constat d’échec émis en 2013 par Jean-Michel Costes, ancien président de l’Office français de lutte contre les drogues et les toxicomanies, dans un numéro spécial de la revue Psychotropes consacré à la législation française sur les stupéfiants, semble particulièrement pertinent pour le cas du cannabis. Depuis la fin des années 1960, la consommation de ce produit, également connu sous les noms de haschich ou de marijuana, n’a en effet jamais cessé d’augmenter. Restée marginale jusqu’à cette date, la substance est aujourd’hui la première drogue illicite consommée dans le pays [2]. Malgré un coût économique élevé pour la collectivité et un insuccès patent à atteindre l’objectif fixé par la loi d’une éradication de son usage [3], l’intervention de l’État relative à la marijuana reste prisonnière des structures juridiques et des représentations des drogues héritées de la loi du 31 décembre 1970, cadre dans lequel se déploie l’action publique française en matière de stupéfiants. L’objectif de ce texte est l’établissement d’un monde sans drogues : il proscrit en effet la production, la vente, la consommation et la promotion d’un certain nombre de produits psychotropes. Dès 1916, la France s’était dotée d’un cadre légal de contrôle du commerce et de l’usage de plusieurs substances, parmi lesquelles le haschich. Au cours du xx e siècle, et sous la pression d’une communauté internationale emmenée par les États-Unis [4], l’option prohibitionniste s’est peu à peu imposée sur l’ensemble de la planète au détriment d’autres modes de gestion collective, de formulation et de résolution du problème public posé par les modificateurs de conscience. La loi de 1970 et l’action publique qui en découle sont les fruits de cette évolution historique dont les enjeux sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, moraux et politiques.
Le constat d’échec émis en 2013 par Jean-Michel Costes, ancien président de l’Office français de lutte contre les drogues et les toxicomanies, dans un numéro spécial de la revue Psychotropes consacré à la législation française sur les stupéfiants, semble particulièrement pertinent pour le cas du cannabis. Depuis la fin des années 1960, la consommation de ce produit, également connu sous les noms de haschich ou de marijuana, n’a en effet jamais cessé d’augmenter. Restée marginale jusqu’à cette date, la substance est aujourd’hui la première drogue illicite consommée dans le pays [2]. Malgré un coût économique élevé pour la collectivité et un insuccès patent à atteindre l’objectif fixé par la loi d’une éradication de son usage [3], l’intervention de l’État relative à la marijuana reste prisonnière des structures juridiques et des représentations des drogues héritées de la loi du 31 décembre 1970, cadre dans lequel se déploie l’action publique française en matière de stupéfiants. L’objectif de ce texte est l’établissement d’un monde sans drogues : il proscrit en effet la production, la vente, la consommation et la promotion d’un certain nombre de produits psychotropes. Dès 1916, la France s’était dotée d’un cadre légal de contrôle du commerce et de l’usage de plusieurs substances, parmi lesquelles le haschich. Au cours du xx e siècle, et sous la pression d’une communauté internationale emmenée par les États-Unis [4], l’option prohibitionniste s’est peu à peu imposée sur l’ensemble de la planète au détriment d’autres modes de gestion collective, de formulation et de résolution du problème public posé par les modificateurs de conscience. La loi de 1970 et l’action publique qui en découle sont les fruits de cette évolution historique dont les enjeux sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, moraux et politiques.
En nous inspirant de l’approche constructiviste des problèmes publics notamment portée par le sociologue Joseph Gusfield, nous souhaiterions donner du sens à l’échec de cette action publique en analysant l’histoire du processus d’interdiction de l’usage de marijuana en France. À l’aide d’un matériau normatif composé des textes de loi français et internationaux mais également d’études socio-historiques des documents de la pratique (statistiques policières et judiciaires, circulaires gouvernementales, etc.), nous étudierons dans un premier temps l’érection de la consommation de cannabis comme « catégorie légitime d’intervention étatique en France [5]» à travers notamment le passage de loi du 12 juillet 1916. Nous nous intéresserons ensuite à l’action publique menée contre le produit dans ce cadre législatif jusqu’au vote de la loi du 31 décembre 1970. Nous verrons en effet que l’échec actuel de l’État dans sa lutte contre les drogues doit pour beaucoup à l’inconstance et aux paradoxes de son intervention antérieure.
Vers l’interdiction partielle de la consommation du cannabis en France : début du xix e siècle – 12 juillet 1916
La première mention du cannabis dans un texte officiel français date de 1800. Au cours de son expédition en Égypte, Napoléon Bonaparte fit prohiber par décret « l’usage de fumer la graine du chanvre » sous peine de sanctions sévères [6]. Promulguée au lendemain d’une tentative d’assassinat perpétrée sur le général par un individu sous ivresse cannabique, cette interdiction ne saurait être considérée comme la première étape d’une véritable action publique. Ne s’appliquant qu’au territoire égyptien, où la consommation de haschich était solidement implantée depuis plusieurs siècles, il semble plutôt qu’il se soit agi d’une disposition de circonstance visant à ne pas compromettre la campagne en prévenant les velléités d’expérimentation de la part des soldats de la Grande Armée. L’expédition de Bonaparte suscita toutefois un vif intérêt pour le produit au sein du corps médical dont certains membres ramenèrent des échantillons en métropole pour en étudier les propriétés [7].
Le régime contemporain des usages de drogues – ludique, expérimental ou toxicomaniaque mais désacralisé, individuel et démocratisé – naît en Europe au cours du xix e siècle, de la conjonction des progrès de la médecine, de la chimie et d’une transformation du rapport de l’individu à soi et à la société [8]. Malgré l’attrait de quelques artistes pour le cannabis au mitan du siècle, parmi lesquels Théophile Gautier ou Charles Baudelaire rassemblés par l’aliéniste Moreau de Tours au sein du Club des haschichins [9], le produit ne figure pas sur la liste des « substances vénéneuses » dont le commerce fut pour la première fois réglementé par la loi du 19 juillet 1845 : suite à une affaire d’empoisonnement retentissante, ce texte chercha en effet à encadrer la circulation de plusieurs produits susceptibles d’être utilisés à des fins criminelles comme l’arsenic ou l’opium [10]. C’est donc dans le cadre de la lutte contre les poisons qu’intervint la première réponse publique en matière de drogues.
Jusqu’au début du xxe siècle, l’État ne considéra le cannabis que d’un strict point de vue économique. Dans une veine colbertiste, la puissance publique française décida en effet de créer des régies chargées d’exploiter et de vendre le haschich : en Tunisie, dès 1881, et au Maroc, en 1914. Produit colonial permettant de dégager de substantiels profits à l’instar de l’opium, la marijuana n’en commença pas moins à être considérée comme un « poison de l’esprit » et sa consommation sévèrement combattue au nom de la lutte contre l’intempérance et la débauche sexuelle [11]. Cet état de fait paradoxal s’explique par la très faible prévalence d’usage de la substance dans l’Hexagone et la tendance de l’État français à appliquer des lois d’exception dans ses colonies, s’opposant presque systématiquement aux principes sociaux, moraux ou sanitaires promus en métropole [12].
La position de la puissance publique relative aux psychotropes évolua dans les premières années du xx e siècle. Dans le contexte mondial de concurrence géopolitique et idéologique de la colonisation, les États-Unis prirent la tête d’un mouvement visant à faire interdire le commerce et la consommation des drogues sur l’ensemble de la planète [13]. Cette croisade prohibitionniste sous-tendue par des motivations sanitaires, morales, économiques mais également raciales [14], engrangea ses premiers succès lors de la tenue des conférences de Shangaï en 1909 et de La Haye en 1912. Encore balbutiante au niveau étatique, l’action publique relative aux drogues se voyait ainsi doublée d’un échelon international d’emblée plus contraignant. Rares sont les pays qui ne suivirent pas les recommandations des textes successifs, restreignant notamment la production, la vente et la consommation des opiacés [15]. En France, la transformation du rapport de la puissance publique aux psychotropes ne fut pas uniquement le fait de forces exogènes. Depuis quelques années déjà, des mouvements d’opinion, inquiets de l’extension – somme toute limitée [16] – de certains usages de drogues, militaient pour l’interdiction de ce qu’ils considéraient être un « fléau social », puis un « péril national » dans les années qui précédèrent le premier conflit mondial. Les discussions parlementaires sur les dangers de l’opium aboutirent ainsi pendant la guerre, dans un contexte d’émotion extrême et de promotion du retour à l’ordre moral [17] : le 12 juillet 1916 fut votée la première loi réglementant « le commerce […] et l’usage en société des substances vénéneuses notamment l’opium, la morphine et la cocaïne [18] ».
Le texte exposait les contrevenants à des sanctions « particulièrement sévères » prenant la forme de fortes amendes et de peines d’emprisonnement [19]. Son originalité résidait surtout dans la création d’une nouvelle catégorie juridique, celle des stupéfiants, soumettant un ensemble hétérogène de substances psychotropes à un régime pénal unique. L’intitulé de la loi ne mentionne pas le cannabis, et l’on peut s’étonner de voir inclus dans la liste des produits stupéfiants le « haschich et ses préparations [20] », alors que leur consommation avait presque disparu de l’Hexagone au début du xx e siècle [21]. Le compte rendu des discussions au Sénat et à l’Assemblée nationale entre août 1913 et juillet 1916 montre que la substance ne fut que rarement mentionnée au cours du processus législatif, contrairement à l’opium et à la cocaïne qui le furent systématiquement [22]. Légiférer sur le cannabis ne semble pas avoir été une priorité pour les parlementaires, ni même d’ailleurs une évidence. Jean-Jacques Yvorel rappelle cependant que le produit persistait alors dans la mémoire collective française sous la forme de représentations distordues. En harmonie avec une médecine qui semblait avoir oublié les connaissances acquises au cours du siècle précédent [23], le législateur pourrait avoir ajouté à la liste cette substance qui avait été quelques décennies plus tôt l’apanage d’une poignée de poètes maudits et de cliniciens travaillant sur la folie. Bien qu’aucune archive consultée n’accrédite cette hypothèse, on ne peut d’autre part exclure que les parlementaires français aient cherché à s’attirer les bonnes grâces des États-Unis chez qui la consommation de cannabis progressait fortement parmi les populations noires et mexicaines du Sud [24]. Dans un contexte de guerre mondiale, il est permis de penser que la puissance publique, au courant des velléités d’éradication planétaire des drogues et de leurs usages par l’État fédéral américain, ait souhaité apparaître en pointe de ce combat dans le but de séduire un pays alors encore officiellement neutre dans le conflit [25].
Quelle qu’en ait été la raison, la loi de 1916 contraignait fortement et pour la première fois la consommation du cannabis en France au nom de la santé publique [26]. D’une manière générale, ce texte relève « de ce que Michel Foucault appelle le bio-pouvoir, une politique systématique de mens sana in corpore sano, qui s’élabore principalement durant la seconde moitié du xix e siècle et les premières décennies du xx e siècle [27] ». La pénalisation du haschich et de ses dérivés était légitimée par son agrégation à un ensemble de modificateurs de conscience perçus comme néfastes pour la santé des individus et le corps social dans son entier. Sous la pression de courants moralistes et hygiénistes internes, et d’un rapport de force international défavorable, le législateur français fit sienne la formulation américaine du problème public posé par les substances psychoactives, ainsi que sa résolution : la prohibition, pour le moment partielle puisque seulement « en société [28] ». Selon Emmanuelle Retaillaud-Bajac, la loi de 1916 mit sur pied un « univers autonome de la drogue » en France [29]. Des circuits économiques et des pratiques autrefois dissociés, des populations de vendeurs et de consommateurs de produits divers se voyaient réunis dans un même ensemble, théoriquement placé sous le contrôle de l’État. L’intégration du cannabis à cet univers constituait, à l’époque, une exception dans le monde [30].
Hésitations et paradoxes de l’action publique française en matière de cannabis jusqu’au vote de la loi du 31 décembre 1970
Fidèle à son habitude de dissocier les législations s’appliquant en métropole et dans ses possessions, l’État français fit en sorte que le passage de la loi de 1916 n’ait « pas des répercussions trop néfastes sur le budget des colonies [31] ». Afin de ne pas compromettre les très rentables monopoles sur l’opium et le haschich, il fut décidé que le ministre de tutelle « [veille] avec les tempéraments qu’imposent à la fois les nécessités budgétaires et de lointaines pratiques, à une sage et prudente application de la loi [32] ». Fléau sanitaire et social dans l’Hexagone, ces substances restèrent des produits comme les autres dans les territoires ultra-marins jusqu’à l’approche de la décolonisation [33]. Si l’émotion présida à la pénalisation du cannabis en métropole, c’est un certain pragmatisme économique qui conduisit à la poursuite de sa production et de sa vente sous l’égide de la puissance publique dans les territoires maghrébins de l’empire.
Selon Emmanuelle Retaillaud-Bajac, l’usage de drogue resta en France dans l’entre-deux-guerres un « fait social [quantitativement stable mais] encore très restreint », dont la « sociologie [ne fut pas] fondamentalement bouleversée » [34]. L’intervention de l’État en la matière semble donc n’avoir eu que peu d’effet. Tout au plus peut-on constater un certain déclassement social du monde de la drogue dû à sa criminalisation, qui s’est traduit par la progression du « pôle crapuleux (trafiquants, prostitués, milieu de la nuit) » au détriment des consommations élitaires ou d’origine thérapeutiques [35]. Au sein de ce panorama, l’usage de cannabis occupa une place tout à fait marginale. Entre 1917 et 1937, il fut impliqué dans moins de 1 % des infractions à la législation sur les substances vénéneuses traitées par les tribunaux parisiens [36]. Dans ces conditions, l’expression « de drogue oubliée » employée par Jean-Jacques Yvorel apparaît véritablement légitime [37]. Une nuance doit cependant lui être apportée : si les artistes se détournèrent en effet du produit après-guerre, celui-ci ne compta en fait jamais plus de quelques centaines à quelques milliers d’adeptes avant les années 1960. En ce sens, la Grande guerre et la loi de 1916 ne constituèrent que des inflexions mineures dans l’histoire sociologique de la consommation de marijuana.
L’entre-deux-guerres vit malgré tout le profil des rares usagers de la substance évoluer. De l’élite artistique, il se déporta vers les couches populaires d’origines étrangères, notamment celles issues de l’empire colonial arrivées en métropole à compter de la Première Guerre mondiale. Malgré la naissance de quelques « fantasmes médiatiques [38] », le cannabis préoccupa peu les différents organes de l’État durant cette période. Dérogeant au principe d’indistinction des substances introduit par le concept de stupéfiant, les juges se montrèrent ainsi plus indulgents avec les consommateurs de haschich qu’avec ceux de morphine ou de cocaïne [39]. Les propriétés psychosomatiques du cannabis ne sont pas étrangères à la plus grande mansuétude dont bénéficia le produit : celui-ci n’entraîne en effet pas de « dépendance comparable à celle suscitée par l’opium et ses dérivés [40] » et apparut certainement moins dangereux à l’institution judiciaire. Cette caractéristique, rendant sa consommation difficilement repérable d’un point de vue policier [41], participa d’autre part à maintenir la pratique dans une relative confidentialité jusqu’aux années 1960.
Dans l’intervalle, la situation légale du produit dans le monde évolua grandement. Les premières mesures internationales visant à contrôler son usage furent prises à la conférence de Genève en 1925 [42]. En 1937, les États-Unis adoptèrent le Marihuana Tax Act, interdisant l’usage individuel de la substance sur tout le territoire fédéral [43]. Porté par le chef du Bureau des stupéfiants, Harry J. Anslinger, ce texte justifiait la prohibition par des arguments moraux et sanitaires souvent extravagants, similaires à ceux qui présidèrent en France à la pénalisation du haschich en 1916 [44]. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs conventions internationales renforcèrent les contraintes pesant sur le commerce et la consommation des stupéfiants, sans pour autant prohiber encore la marijuana. La France sembla s’engager dans cette voie à partir de 1953 : le ministre de la Santé publia un décret pénalisant la consommation des « sommités florifères et fructifères » du cannabis [45], alors que le produit était retiré de la pharmacopée nationale. Cette tentative d’incrimination de l’usage individuel resta cependant lettre morte car aucune sanction ne fut définie à l’encontre des éventuels transgresseurs. D’autre part, une loi envisagea de coupler la réponse pénale à l’encontre des usagers de drogues à « une astreinte […] à subir une cure de désintoxication [46] ». Voté dans un contexte de progression de l’« espace politique de la santé [47] » en direction des modificateurs de conscience qui se traduisit par exemple par la mise en place d’une « surveillance sanitaire des alcooliques dangereux pour autrui » en 1954 [48], ce texte ne fut « jamais mis en vigueur, le règlement d’administration publique prévu pour son application n’ayant jamais vu le jour [49] ». La marginalité du problème public encore posé par les stupéfiants et l’existence d’une législation déjà sévère semblent ainsi n’avoir pas engagé les autorités au zèle en la matière.
Les années 1960 constituèrent une rupture dans l’histoire plurimillénaire des usages de drogues à l’échelle planétaire : d’« épiphénomène [50] », ces derniers passèrent au statut de fait social de grande ampleur. Au cours de la décennie précédente, les auteurs de la Beat Generation avaient popularisé le dérèglement des sens et l’autodestruction sur un mode rimbaldien à l’aide du LSD et de la marijuana [51]. Inquiets de la propagation manifeste des drogues sur leur territoire, les autorités américaines décidèrent de la tenue d’une nouvelle conférence internationale appelée à jeter les bases d’une « prohibition mondiale des stupéfiants [52] ». Le sommet qui se tint à New York en 1961 interdit ainsi la production, le commerce, et la consommation des principales drogues connues à l’époque, parmi lesquelles le cannabis, classé parmi les « substances les plus dangereuses pour lesquelles les contrôles les plus stricts [devaient] être appliqués [53] ». Débarrassée des considérations économistes par la perte de ses territoires coloniaux, la France se rangea derrière cette position intransigeante sans pour autant la traduire immédiatement dans son droit national. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961, ratifiée par la majorité des pays du monde, constitue aujourd’hui encore l’ossature de l’action publique internationale en matière de drogues, bien que des textes ultérieurs soient venus l’infléchir dans un sens plus rigoureux.
Malgré la reconnaissance planétaire de son caractère illégal, l’usage de cannabis ne cessa de s’étendre au cours de la décennie. Dans un contexte de fusion entre les opposants à la guerre du Vietnam et la contre-culture hippie, les étudiants californiens se saisirent de cette pratique incarnant un mode de vie alternatif, la quête d’un ailleurs tant psychique que géographique et la lutte contre les valeurs jugées aliénantes de la société de consommation [54]. Cette vague psychédélique atteint son apogée outre-Atlantique au cours de l’été 1967 qui vit San Francisco transformée en capitale du mouvement hippie. Suivant l’exemple états-unien, une partie de la jeunesse européenne se mit à consommer en masse du LSD mais surtout du cannabis à des fins ludiques et expérimentales. Le phénomène atteint la France entre 1969 et 1971 : profitant du déclin des mouvements gauchistes et de l’impasse politique de Mai 68 [55], les avatars psychotropiques de la contre-culture américaine gagnèrent progressivement les franges estudiantines et « petite[s]-bourgeoise[s] » des cohortes du baby-boom [56]. Quittant les marges ethniques et sociales, le cannabis passa de substance confidentielle à premier produit illicite consommé dans le pays. Devant la nouveauté du phénomène, la presse se fit l’écho alarmiste de faits divers impliquant des quantités parfois négligeables de drogues [57]. La situation semblait d’autant plus inquiétante que le phénomène concernait une jeunesse en mutation rapide, habituée à l’abondance et habitée d’un rapport nouveau à l’autorité, aux traditions et aux interdits [58]. Plus qu’une nouvelle pratique mettant en péril la santé publique, la consommation de cannabis apparut donc comme le symbole d’une transformation radicale et inéluctable des normes et des valeurs de la société française.
Au cours de l’été 1969, la mort par overdose d’héroïne de plusieurs jeunes à Bandol finit de plonger le pays dans un état de « panique morale [59] ». Le schéma de 1916 se répétait : la vive émotion de l’opinion engagea les pouvoirs publics à agir dans l’urgence [60]. Malgré l’existence d’une législation déjà restrictive, il fut décidé de légiférer. La loi du 31 décembre 1970 s’inspirait des textes antérieurs : de la loi de 1916, elle reprenait le concept juridique de stupéfiant, ne distinguant pas les substances. De la loi avortée de 1953, elle reprenait l’idée paradoxale que l’usager était à la fois malade et délinquant. Elle innovait cependant, instaurant pour la première fois l’incrimination de l’usage solitaire des stupéfiants [61], stade ultime du processus d’éradication des drogues par la puissance publique initié au début du siècle. La lutte contre les psychotropes investissait d’autre part le terrain culturel puisque la loi menaçait d’amende toute « provocation [à l’usage] au moyen de l’écrit […], de la parole ou de l’image » d’un produit stupéfiant [62], restreignant par-là les possibilités d’évoquer et de représenter la consommation de drogues. Un nouveau cadre d’action publique, correspondant à la philosophie de la « guerre à la drogue » décrétée à la même époque par l’administration Nixon, était posé en France, prônant l’abstinence, criminalisant les usagers et « diabolisant […] la drogue et [les] dealers [63] ». Il réservait théoriquement aux centaines de milliers d’expérimentateurs de cannabis un sort similaire aux héroïnomanes : amende, voire prison, et prise en charge par l’autorité sanitaire.
Les fondements historiques de l’impasse actuelle
La puissance publique française n’a jamais lutté contre la consommation du cannabis pour les bonnes raisons jusqu’en 1970. Concession faite dans des pourparlers internationaux et volonté d’assainissement moral en 1916, puis abandon d’un monopole commercial et conversion à l’option prohibitionniste américaine en 1953 rendent en effet mieux compte du processus d’interdiction de la substance que les arguments sanitaires mobilisés à intervalles réguliers par le législateur. La prohibition de la marijuana en France semble ainsi traduire l’évolution d’un rapport de force idéologique, économique et géopolitique ayant progressivement consacré les États-Unis comme nouveaux garants de l’ordre international, plus qu’une véritable prise en compte par l’État de la réalité sociologique des usages de la substance dans le pays. Jusqu’à la fin des années 1960, on ne saurait en effet trouver de corrélation entre la hausse de la pratique dans l’Hexagone et les transformations successives des cadres légaux de l’action publique la concernant.
Assimilée à un ensemble de drogues dont la dangerosité et la prévalence étaient sans commune mesure, la marijuana fut placée par la loi de 1916 sous un statut juridique ne correspondant en rien au problème de santé public effectif qu’elle faisait peser sur la population française. Lorsque son usage crût subitement à la fin des années 1960, la sévérité longtemps inappliquée de la loi ne fut d’aucun secours pour endiguer la massification d’une pratique jusque-là restée marginale. Plutôt que de repenser en profondeur l’approche des drogues et de leurs consommations pour combattre efficacement le phénomène d’une toxicomanie de masse qui se profilait à l’horizon, le législateur reprit dans la loi de 1970 les éléments les plus contestables des textes antérieurs : la catégorie englobante des stupéfiants forgée à l’époque de l’hygiénisme et des ligues de tempérance, la liste des substances contenues en son sein, le double statut du consommateur, à la fois malade et délinquant, etc. Si l’action, à proprement parler, de la puissance publique a depuis évolué, privilégiant le principe de réduction des risques, l’individualisation de la réponse en fonction du produit et du rapport de l’usager à son égard et l’abandon des poursuites pénales pour les simples consommateurs de cannabis, la persistance de cadres législatifs obsolètes constitue un frein à une intervention optimale des différents acteurs de la santé publique.
Cet échec à traiter collectivement des modificateurs de conscience dans la société française tient peut-être au fait qu’aucun débat national serein n’a pour le moment été mené sur la question. En 1916 comme en 1970, c’est l’émotion de l’opinion publique qui a conduit à la mise en place dans l’urgence d’un encadrement des usages de psychotropes par l’État. Si l’histoire permet de tirer des leçons pour le présent, il semble qu’une révision de la loi de 1970 ne doive pas attendre qu’un cataclysme ou des événements tragiques viennent mettre à l’agenda cette question touchant à des champs aussi sensibles que la santé, la morale et l’économie.
Source : L’action publique française en matière d’usage de cannabis, Les fondements historiques d’un échec. Erwan Pointeau-Lagadec. Dans la revue « Hypothèses 2016« , pages 121 à 132 ( mis en ligne en 2016 )
>>Lire aussi : La CND à Vienne : une valse à mille temps?
Notes
- [1] J. M. Costes, « De la guerre à la drogue à la prévention des addictions : à quand l’ouverture de l’impossible débat ? », Psychotropes, 19-1 (2013), p. 13.
- [2] M. L. Tovar, « Niveaux de consommation de substances psychoactives et évolutions », dans Drogues et addictions, données essentielles, J. M. Costes dir., Saint-Denis, 2013, p. 35.
- [3] C. Ben Lakhdar et M. Tanvé, « Évaluation économique de la loi du 31 décembre 1970 réprimant l’usage et le trafic de stupéfiants », Psychotropes, 19-1 (2013), p. 46.
- [4] J. M. Costes, « De la guerre à la drogue… », art. cité, p. 22.
- [5] V. Dubois, « La sociologie de l’action publique. De la socio-histoire à l’observation des pratiques (et vice-versa) », dans Historicités de l’action publique, P. Laborier et D. Trom dir., Paris, 2003, p. 347.
- [6] R. N. Dufriche-Desgenettes, Histoire médicale de l’armée d’Orient, Paris, 1812, p. 184.
- [7] D. Richard et J.-L. Senon, Le Cannabis, Paris, 2002, p. 36.
- [8] J.-J. Yvorel, Les Poisons de l’esprit. Drogues et drogués au xix e siècle, Paris, 1992, p. 9-13.
- [9] Ibid., p. 45.
- [10] Ibid., p. 56-57.
- [11] Ibid., p. 59.
- [12] O. Le Cour Grandmaison, « L’exception et la règle : sur le droit colonial français », Diogène, 212-4 (2005), p. 42-64.
- [13] F. Caballero et Y. Bisiou, Droit de la drogue, Paris, 2000, p. 739 (1re éd. 1990).
- [14] T. Szasz, Les Rituels de la drogue, Paris, 1976, chap. 6.
- [15] I. Charras, « Genèse et évolution de la législation relative aux stupéfiants sous la Troisième République », Déviance et société, 22-4 (1998), p. 368.
- [16] E. Retaillaud-Bajac, « Du haschichin au drogué, constances et mutations de la sociologie des usagers de drogue (1916-1939) », Le Mouvement social, 197-4 (2001), p. 84.
- [17] I. Charras, « Genèse et évolution de la législation… », art. cité, p. 372.
- [18] Journal officiel, 14 juillet 1916, p. 6254.
- [19] I. Charras, « Genèse et évolution de la législation… », art. cité, p. 374 et 385.
- [20] J.-J. Yvorel, « La loi du 12 juillet 1916. Première incrimination de la consommation de drogue », Les Cahiers Dynamiques, 56-3 (2012), p. 130.
- [21] J.-J. Yvorel, Les Poisons de l’esprit…, op. cit., p. 145-146.
- [22] Journal officiel, août 1913 à juillet 1916.
- [23] J.-J. Yvorel, Les Poisons de l’esprit…, op. cit., p. 145.
- [24] D. Richard et J.-L. Senon, Le Cannabis, op. cit., p. 40.
- [25] A. Kaspi, Les Américains. I : Naissance et essor des États-Unis, Paris, 1986, p. 300-304.
- [26] J.-J. Yvorel, « La loi du 12 juillet 1916… », art. cité, p. 132.
- [27] Michel Foucault, cité dans J.-J. Yvorel, Les Poisons de l’esprit…, op. cit., p. 241.
- [28] J.-J. Yvorel, « La loi du 12 juillet 1916… », art. cité, p. 130.
- [29] E. Retaillaud-Bajac, « Du haschichin au drogué… », art. cité, p. 83.
- [30] D. Richard et J.-L. Senon, Le Cannabis, op. cit., p. 112.
- [31] I. Charras, « Genèse et évolution de la législation… », art. cité, p. 379.
- [32] Ibid., p. 382.
- [33] F. Caballero et Y. Bisiou, Droit de la drogue, op. cit., p. 509.
- [34] E. Retaillaud-Bajac, « Du haschichin au drogué… », art. cité, p. 86 et 99.
- [35] Ibid.
- [36] Ibid., p. 89.
- [37] J.-J. Yvorel, Les Poisons de l’esprit…, op. cit., p. 145.
- [38] E. Retaillaud-Bajac, « Du haschichin au drogué… », art. cité, p. 94-95.
- [39] I. Charras, « Genèse et évolution de la législation… », art. cité, p. 375.
- [40] E. Retaillaud-Bajac, « Du haschichin au drogué… », art. cité, p. 89.
- [41] Ibid., p. 94.
- [42] F. Caballero et Y. Bisiou, Droit de la drogue, op. cit., p. 512.
- [43] Ibid., p. 742.
- [44] Le cannabis, « assassin de la jeunesse » selon Harry J. Anslinger, entraînait ses consommateurs dans une « rage délirante » ou était la cause d’une « dégénérescence mentale » menant à la commission de « crimes révoltants ». Ibid., p. 510.
- [45] Journal officiel, 28 mars 1953, p. 2976.
- [46] Journal officiel, 25 décembre 1953, p. 11535.
- [47] D. Fassin, L’Espace politique de la santé. Essai de généalogie, Paris, 1996.
- [48] L. Simmat-Durand et T. Rouault, « Injonctions thérapeutiques et autres obligations de soins », Revue Toxibase, 3 (1997), p. 1.
- [49] Ibid.
- [50] G. Mauger, « L’apparition et la diffusion de drogues en France (1970-1980). Éléments pour une analyse sociologique », Contradictions, 40-41 (1984), p. 136.
- [51] B. Lemmonier, « La folie LSD », L’Histoire, 266 (2002), p. 49.
- [52] F. Caballero et Y. Bisiou, Droit de la drogue, op. cit., p. 44.
- [53] C. Martel, « Les législations européennes relatives au cannabis et leurs évolutions récentes », dans Cannabis, données essentielles, J.-M. Costes dir., Saint-Denis, 2007, p. 142.
- [54] M. Tsikounas, « Le cannabis en représentation », Alcoologie et Addictologie, 28 (2006/2), p. 95.
- [55] G. Mauger, « L’apparition et la diffusion de drogues… », art. cité, p. 134.
- [56] Ibid., p. 139.
- [57] V. Benso, « Le paysage médiatique des drogues à la fin des années 1960 », Swaps, 60-3 (2010), p. 9.
- [58] J.-F. Sirinelli, « Des “copains” aux “camarades” ? Les baby-boomers français dans les années 1960 », Revue historique, 626-2 (2003), p. 332.
- [59] S. Cohen, Folks Devil and Moral Panics, Londres, 1972, p. 9.
- [60] I. Charras, « Genèse et évolution de la législation… », art. cité, p. 385.
- [61] Ibid., p. 367.
- [62] Journal officiel, 3 janvier 1971, p. 76.
- [63] J.-M. Costes et A. Wellenstein, « Les campagnes de communication sur les drogues sont-elles efficaces et utiles ? », Psychotropes, 20 (2014/3), p. 57.








